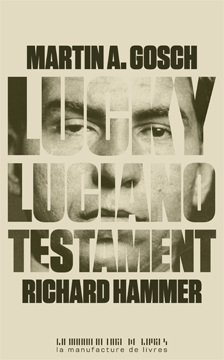Lucky Luciano - Testament
Martin A. GOSCH , Richard HAMMER
Traduit par Éric Balmont
Petit immigré sicilien dans le New York des années 1900, Luciano fait les quatre cents coups avec d’autres gamins du Lower East Side : Meyer Lansky, qui restera son ami, Frank Costello ou Bugsy Siegel. Viendront ensuite Al Capone, Vito Genovese, Joseph Bonanno, Dutch Schultz ou Nucky Johnson. C’est le temps du trafic d’alcool, des braquages et des règlements de comptes. Luciano veut bousculer les vieilles traditions de la mafia, et devient, après une guerre sanglante, le chef des cinq familles de Cosa Nostra. Lorsque les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale, Lucky Luciano profite de la situation : c’est lui qui contrôle les ports américains, pièces maîtresses de l’effort de guerre. Les services secrets vont aussi l’utiliser pour faciliter le déroulement de l'invasion de la Sicile en 1943. Considérant les énormes bénéfices potentiels d'un marché en pleine expansion, il va, à la fin de sa vie, tisser des liens avec les mafias italiennes et organiser le trafic international de stupéfiants avec les Corses et la pègre marseillaise. C’est à partir de ces mémoires que Mario Puzo et Francis Ford Coppola ont créé le personnage mythique de Don Corleone dans le Parrain.
Les Auteurs

Martin A. GOSCH
Martin A. Gosch est un producteur hollywoodien. Proche de Lucky Luciano, il l'avait embauché comme consultant pour un film sur la mafia américaine qui ne vit jamais le jour.

Richard HAMMER
Né en 1928, Richard Hammer est un journaliste et auteur américain. Il a remporté plusieurs distinctions prestigieuses pour son travail d'investigation.