
Christian ROL
Christian Rol est reporter et journaliste. Il a collaboré aux journaux Choc et Le Figaro.

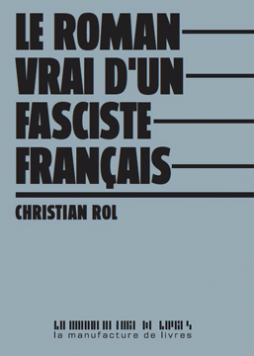
BIOGRAPHIE
19,90 euros - 336 pages
Parution le 24/04/2015
ISBN 978-2-35887-099-3
COLLECTION
DOCUMENTS
Le 4 mai 1978, Henri Curiel, militant communiste et anticolonialiste, membre du réseau Jeanson des “porteurs de valises” est abattu à son domicile parisien. Le 20 septembre 1979, Pierre Goldman, figure de l'extrême gauche des années 1970, est tué par balles à bout portant à quelques mètres de chez lui dans le 13e arrondissement. Ces assassinats qui ne seront jamais élucidés sont signés par une organisation d'extrême droite inconnue : Honneur de la Police. En 2012, peu avant de mourir, un individu discret revendique — à visage couvert — sa participation à l’assassinat de Pierre Goldman. Quant à l’autre "exécution" dont il assume la paternité auprès de quelques proches, elle est pour la première fois révélée dans ce livre.
Camelot du roi et membre de l'Action française à quatorze ans, René Resciniti de Says est un ancien parachutiste du 9e RCP, puis du 6e RPIMA. Parti guerroyer dans les Phalanges libanaises, et en Afrique aux côtés de Bob Denard, il a également été "instructeur militaire" en Amérique latine : un "affreux”.
Loin d’être un nervi au front bas, mais ne dédaignant pas l’étiquette de “voyou “, Resciniti de Says est un authentique marquis italien né des noces bâclées entre une mère chanteuse lyrique et un père aventurier parti très tôt du domicile conjugal sur les Champs-Élysées. En outre, s’il est "monarchiste", dandy aux élégances onéreuses, ses amitiés, elles, ne le sont pas toujours… et sa conduite non plus. La personnalité baroque de René Resciniti de Says — ce lettré peut déclamer des vers, ivre devant l’Institut après une nuit à se battre —, sa vie et sa complexité nous épargnent l’écueil du registre "fana-mili facho" réducteur et sclérosant. D’abord, parce qu’il ne fut pas que cela. Sa vie nous renvoie aussi bien au cinéma qu’à la littérature, deux registres qu’il prisait tant. Où l’on passe allègrement des Quatre-cents coups à La Fureur de vivre — il vouait dans ses jeunes années une adoration à James Dean — à la langue d’Audiard d’un Paris interlope, à Beyrouth sous le feu ; et aux personnages de Blondin à qui il ressemblait tellement à la fin de son existence.
Christian Rol revient sur les assassinats commandités au plus niveau, mais au-delà du document choc et de l’affaire d’État dont il fut la main armée par les "services", il s’immerge aussi dans une jeunesse agitée au cœur des groupuscules politiques de droite : Occident, Ordre nouveau et Action française, qui ensanglantèrent le Quartier latin des années 1960 et 1970 ; et qui furent un vivier riche en gros bras pour les services parallèles du pouvoir de l’époque et en futur leaders politiques de la France d’aujourd’hui. Il donne là un "roman vrai" d’un personnage picaresque avec qui nous voyageons d’un monde à l’autre en embrassant un destin hors norme.
BIOGRAPHIE
19,90 euros - 336 pages
Parution le 24/04/2015
ISBN 978-2-35887-099-3
COLLECTION
DOCUMENTS

Christian Rol est reporter et journaliste. Il a collaboré aux journaux Choc et Le Figaro.
20 avril 2012, Paris
Une foule compassée, recroquevillée sous le soleil froid de Paris en avril, se presse autour de la petite église Saint Germain l’Auxerrois face à la magnificence du Louvre. Une majorité d’hommes vêtus de sombre, et quelques jolies femmes élégamment éplorées, viennent rendre un dernier hommage à René Resciniti de Says, « Néné » pour les intimes, ou bien encore « René l’Élégant », un surnom de voyou parigot pour cet aristo franco-italien qui n’aimait rien tant que le mélange des genres.
C’était son dernier printemps… un printemps maussade comme cette époque dans laquelle il ne se reconnaissait plus. Le sérieux de ses temps sans grâce ne le concernait pas. Lui, dont la vie a été une farce tragique, s’est éteint comme il a vécu : de manière absurde. Une tranche de gigot fatale est venue mettre un terme à une tranche de vie peu banale…
Certes, cette mort grotesque ne ressemble guère au personnage que ses amis proches imaginaient plutôt dans la peau d’un macchabée criblé de balles, ou une cible opportunément « suicidée » par des barbouzes ou des voyous. Même le curé, dans son homélie, s’étonnera à voix haute en regardant le cercueil : « Si on m’avait dit que celui-là mourrait dans son lit… »
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement Néné que nous enterrons ; c’est notre jeunesse.
Ses amis ? Ils sont venus, ils sont tous là : anonymes pour la plupart, mais pas pour tout le monde. Notamment pour les Renseignements, Généraux ou particuliers, qui se faufilent entre les petits groupes de gaillards émus comme des enfants attendant de pénétrer à l’intérieur de l’église.
Pourquoi les flics ?
Parce que parmi cette assemblée de fidèles – fidèles à Néné surtout – il n’est guère d’enfants de chœur. Derrière les mises bourgeoises de ces messieurs, l’œil averti reconnaîtra d’anciens mercenaires qui firent le coup de feu au Liban ou en Afrique en compagnie de « petit René » ou « Max » - autres pseudos -. Il y a aussi quelques voyous plus ou moins rangés des voitures qui doivent leur fortune à l’habileté de leur ancien obligé. On y reconnaît aussi d’anciens activistes d’extrême droite évoquant entre eux les faits d’armes de ces années soixante-dix quand leur jeunesse côtoyait celle de ce camelot intrépide capable de corriger à lui seul trois gauchistes. Le sang bleu fut en effet un sanguin.
Ce n’est pas la cour des miracles mais presque, à laquelle viennent s’agréger des aristos en rupture de ban, des Italiens pas très catholiques, des Juifs pas très orthodoxes, des Africains pas blancs bleus et deux ou trois francs-maçons bien « logés ». On y croise aussi un Préfet - hors cadre sinon hors norme - des demi-folles, des demi-mondaines, de vrais dingues, des marquis, un descendant des rois de France, un scénariste richissime, une cinéaste gironde, des journalistes amis, des intellos, deux ou trois historiens, un trafiquant d’armes, des zélateurs de la Restauration Nationale, des contempteurs de la restauration rapide, des chevaux de retour du Jockey Club, des tailleurs sur mesure, un producteur notoire de disques ennuyeux et des dandys désormais orphelins de leur avocat des élégances parisiennes.
Des avocats, précisément, des « baveux » comme disait Néné, il y en a pléthore. Ils viennent de perdre leur meilleur client… quand bien même celui-ci ne payait jamais le moindre honoraire.
Point de famille pour cet orphelin des causes perdues. Sa seule tribu, ce sont ces hommes et ces femmes, cette mosaïque hétéroclite d’individus qui ont croisé un jour la route de René et qui se réunissent pour la première fois, et sans doute la dernière, sous l’étendard baroque de l’Action Française, le mouvement monarchiste auquel Néné demeura fidèle sa vie durant.
Quant aux femmes présentes, auxquelles il fut si peu fidèle – sinon à toutes – elles résument un tant soi peu la vie amoureuse de l’homme à femmes, sinon de l’homme à fables.
Des putains, des aristos, des artistes et des jeunes filles en pleurs se signent au passage du cercueil porté sur le parvis par de jeunes camelots. Chacune d’elles, mais une en particulier qu’il considérait comme sa femme – elle qui savait tout mais jamais n’a trahi – est un pan de cette fresque.
Et puis, il y a moi, simple quidam, vaguement auteur.
J’enterre aujourd’hui le héros de mon enfance quand René, la vingtaine à peine venait à la maison rejoindre les aînées de notre fratrie dans leur piaule adolescente. C’était au temps des Who, de Pompidou, des fusées sur la lune et des pattes d’éléphant ; au lendemain de mai 1968, sillage que Néné prit très vite à contre-courant.
Depuis mon enfance je n’ai cessé de croiser Néné. Parfois, je n’avais plus de nouvelles pendant des années – on le disait « à l’étranger » – et il réapparaissait, tantôt riche, sapé sur-mesure et vivant dans le Triangle d’Or avec une princesse africaine ; tantôt maigre et mal rasé, flottant dans des hardes chiffonnées, claudiquant dans de méchantes chaussures, portant à bout de bras dans un sac élimé son petit chien Rocky, tout ce qui lui restait de sa défunte mère.
Pouvais-je me douter que le petit garçon plein d’admiration pour ce jeune voyou racé, une sorte de James Dean des beaux quartiers, il vivait sur les Champs-Élysées, pouvais-je me douter alors qu’un jour je conterais sa vie ?
Chez Dominique, notre restaurateur et ami, témoin de nos libations, au cours de conversations informelles, quelques bribes de sa vie hors normes prirent avec le temps, et dans mon esprit, la forme de ce livre. Ces dernières années, René devenait bavard… Sans doute, jouant de mon inconditionnel intérêt pour lui, il en charriait des tonnes, contant de sa verve parigote une fresque trop parfaite pour être authentique.
Avait-il fait tout ce qu’il racontait ou alors le mythomane était-il si habile que tout l’édifice fantasmagorique édifié depuis quarante ans était de ce marbre dans lequel on grave les légendes ? Je l’ignorais encore.
Même si je prenais soin de trier, je commençais à avoir de la matière, de la dynamite même, et la langue verte de mon ami relevait le tout à la manière d’une sauce subtile. Pour autant, même si la confiance dont il m’honorait était sans faille, René, inquiété par un sixième sens qui n’appartenait qu’à lui, un instinct d’homme traqué - il ne vécut jamais longtemps à la même adresse et changeait souvent d’identité - fit machine arrière. « Non, décidément, je ne peux pas faire ce livre ou bien on me flinguera » me confie-t-il une des dernières fois où je le vis.
Bien sûr, depuis quelques années, mon admiration s’était émoussée devant la décrépitude. Mais non pas ma profonde affection. Même si le dandy aventureux avait viré clochard ou presque, quémandant ici et là quelques euros pour des clopes ou une mousse, vivant de la générosité de ses amis et de l’indulgence de ses femmes, il ne me prit jamais l’inélégance de brûler ce que j’avais aimé. D’ailleurs depuis quand brûle-t-on une tête brûlée ?
Et puis voilà. René est mort ; dans les bras de Blandine et Olivier Perceval, ses derniers bienfaiteurs. La nouvelle s’est propagée en quelques heures via le net, pétrifiant notre nébuleuse dans un chagrin insoupçonnable, réunissant pour la première et dernière fois les cercles concentriques de sa vie.
Sa mort a levé le contrat moral qui nous liait. S’il était exclu de publier quoique ce soit de son vivant sans son aval, en revanche, rien ne s’opposait à ce que ce récit ne lui survive point. Encore fallait-il prendre soin de ne pas heurter quelques susceptibilités alentour et m’assurer que certains amis de mon ami me donneraient leur feu vert. Dans ce genre d’affaire, on n’est jamais trop prudent…
J’eus le feu vert en question mais à condition de demeurer dans les clous. C’est-à-dire de ne pas jeter en pâture les noms de gens qui n’ont aucun intérêt à une telle publicité. Parler, OK, mais sous pseudonyme. D’autres m’ont fait l’amitié de s’exprimer sous leur véritable identité.
Pourquoi tant de prudences ? Parce que René l’Élégant, même après sa mort, demeure un objet à manier avec précaution ; comme une bombe à retardement…
Chapitre I
Gigot fatal
La banlieue un dimanche, c’est un avant-goût de l’enfer. Même les banlieues bourgeoises. Rien ne bouge. Ni le temps, ni les arbres, ni les êtres. Tout est pétrifié dans l’ennui de ces heures sans rides où tout semble vain, où l’on attend le lundi blême, RER surpeuplé, aisselles vaporisées et travail débilitant qui libéreront enfin de la parenthèse lugubre.
Pour René qui n’a jamais travaillé de sa vie et ne sait rien de l’ébullition d’un lundi, ce dimanche à Fontenay a le charme douteux de l’exotisme. Pour autant, lui si prompt d’ordinaire à critiquer tout ce qui l’éloigne de son univers – c’est-à-dire de Paris – ne songerait à cracher dans la soupe que Blandine et Olivier Perceval lui servent depuis trois ans ; depuis que le couple l’a accueilli dans son pavillon. « Recueilli » serait d’ailleurs plus juste tant il est vrai que, lorsque les Perceval - leurs enfants et leur chien - ont offert l’hospitalité à « l’Élégant », celui-ci était à court de bourse et à bout de course ; bref, à bout de souffle. Et à presque soixante ans, après une vie d’aventures, de drames, d’escroqueries et de coups, René n’avait plus l’énergie, ni l’envie de se refaire.
Quant au pognon, on verrait plus tard…
En attendant de descendre déjeuner, il fume une cigarette à la fenêtre de sa chambre. Dehors, il fait gris, comme d’habitude. Finalement, la seule sortie de la journée aura été pour la messe ce matin. Une saine, mais très récente occupation pour René qui a renoué sur le tard avec ce rituel que lui et sa génération tuèrent à force de dérision. Et Blandine n’est pas étrangère à ce retour de foi quand, une fois, une fois seulement, il lui confiait cette culpabilité, ce drôle de sentiment si longtemps ignoré, qui monte en lui comme une lueur sombre.
«Putain de dimanche à la con ! » grommelle-t-il en tirant une dernière taffe. Le spleen, cette mâle mélancolie dont il a toujours tenté de noyer les miasmes dans l’action, gagne chaque jour un peu plus de terrain. Mais aujourd’hui, c’est l’apothéose ! Une angoisse inédite – lui qui a largement éprouvé et vaincu toutes les formes de peur – l’immobilise. Il regarde sans le voir le paysage morne de cette banlieue incongrue. Il gamberge sur ses vies d’avant dont il ne lui reste rien ; si ce n’est des souvenirs, des copains, quelques costumes sur mesures et des pompes anglaises. Les Blandine-Olivier, eux, ils sont l’Auvergnat de Brassens. Ils lui ont réchauffé le cœur quand dans sa vie il faisait froid.
- À table René ! entend-il Blandine l’appeler depuis le rez-de-chaussée.
- J’arrive !
Elle est sympa Blandine… Les mômes aussi. Et l’Olivier, c’est un frangin. Mais il est des jours où il aimerait être seul, ne pas avoir à faire son numéro, à payer le gîte et le couvert en amusant la galerie. Oh ! On ne lui demande rien mais son élégance à lui c’est de faire comme si. Il est comme ça. Alors, avant de faire son entrée, l’artiste se plante devant le miroir pour revêtir la tenue de gala – celle de tous les jours : complet Prince-De-Galles – sur-mesure, bien sûr –, cravate Hermès et groles de chez Lobb. 15 000 Euros de frusques et pas un flèche dans les poches ! Peu importe. Ce qu’on attend de lui ce sont ces trésors de rhétorique et sa culture à faire pâlir un normalien. Et puis, surtout, toutes ces anecdotes, ses frasques qu’il conte d’une verve argotique, imagée et ponctuée de références hilarantes. Il le sait, voilà ce qu’on attend de lui. Alors, aujourd’hui encore, il jouera au boute-en-train désabusé, il jouera à être lui-même et aussi à « L’Oncle René ».
Après le déjeuner, l’on s’est installé au salon. René, entouré de Blandine et Olivier, de leurs quatre jeunes filles et des deux garçons, savoure les joies dominicales et post-prandiales en refaisant le monde autour d’un café. Évidemment, le gigot de Blandine était trop cuit mais comme dit René, après le lui avoir fait remarquer avec une fausse commisération, « c’est l’intention qui compte ».
Dans ce salon, les affinités politiques tiennent du pléonasme et expliquent pourquoi le vieux voyou a trouvé refuge chez ce couple bourgeois – et même aristocratique du côté de Blandine qui imposait le voussoiement à sa progéniture – qui, comme René, a milité à l’Action Française.
Au sein de la « Vieille Maison » édifiée par Charles Maurras, la solidarité n’est pas un vain mot pourvu que se greffent les compatibilités humaines. Et puis, pour Olivier, héberger René allait de soi. Avec cette légende du Mouvement, c’était un peu de baroque qui entrait chez eux. Même si, pour Olivier, dont le père s’est battu dans la 2e DB et a participé à la Libération de Paris, les positions parfois pétainistes de René sont inacceptables et le prétexte à des engueulades tonitruantes.
Pour Blandine à qui revint le dernier mot au moment de prendre la décision – lourde ! – d’offrir un toit à ce marginal vivant dans une semi-clandestinité, non loin de la clochardisation, c’était également une évidence, un sacrifice consenti de bon cœur par cette catholique pratiquante et intransigeante dont la maxime est : « Chez nous, les mecs ont des couilles, et les femmes du cœur. » Dont acte.
Mais compassion n’est pas raison. Derrière la gouaille parigote et le phrasé qui monte facilement dans des aigus dignes de Popeye, le charme de Néné agit comme un aimant, un charisme reposant sur les contraires, les paradoxes, les aspérités et les nuances. Il peut aussi bien vanter le cul des filles - sujet banni chez ses hôtes - que le royaume de Venise ou l’œuvre de Balzac dont il s’est entiché depuis quelque temps. Du cinéma de Grangier à Pasolini en passant par toutes les pochades gratinées de Max Pecas, ce cinéphile en remontrerait aux précieuses des Cahiers du Cinéma. D’ailleurs, n’est-il pas devenu depuis très récemment, l’ami du scénariste Olivier Dazat, biographe et complice de Gérard Depardieu ? Et Eva Ionesco, réalisatrice d’un premier nanar matraqué par la branchitude parisienne ne songe-t-elle pas, après sa Little Princesssorti en 2010, à adapter sur grand écran la vie de René l’Élégant qu’elle rencontrait lors d’un dîner en ville… que le principal intéressé escomptait prolonger dans le lit de la belle névrosée ?
Certes, à soixante ans, René n’affiche plus exactement les traits de ce jeune parachutiste dont on a encadré la photo dans la salle à manger. C’est lui quand il n’avait pas encore vingt ans au premier Régiment de Chasseurs Parachutistes de Toulouse. Un petit blond – de ce blond vénitien hérité de sa mère – aux yeux bleus, aux traits fins et aux épaules larges qui te regarde avec un mélange d’ironie, de défi et d’insolence. À ce moment, s’il est une expression que le chérubin coiffé du béret rouge des paras ne maîtrise plus, c’est bien cette impalpable dangerosité qui émane de lui. Non point cet air bravache et sûr de soi qu’on affiche lorsqu’on a vingt ans, mais ce reflet involontaire de l’âme qui est la vérité.
Depuis toujours, René exerce son charme sulfureux auprès des hommes qui se disputent son amitié. Il est le pote par excellence, le complice, le socle. Chez les voyous, on savait qu’on pouvait compter sur lui. Ainsi que chez les militants et les soldats de Fortune. Et, à la table de la vieille noblesse européenne qu’il honorait de sa présence, chacun s’accordait à vanter le commerce élégant de ce drôle de marquis italien, descendant du royaume de Naples.
Quant aux femmes, selon une perception qui n’appartient qu’à elles, elles ont tôt fait de jauger le personnage. Ce n’est pas tant cette mâle expression, et, somme toute, banale, qui désigne à leurs hormones l’amant idéal mais cette présence, ce regard bleu laser dont lui-même n’est pas maître. Les femmes aiment les hommes qui aiment les femmes. Et elles sentent chez lui cet abandon devant la féminité, cet intérêt sincère, cette absence, souvent, d’arrière-pensées aux antipodes des vieux trucs du macho lourdingue. Comme il dit, quand certaines soulignent ce trait de caractère : « C’est le propre des fils qui ont été élevés uniquement par leur mère. Soit, ils deviennent pédés, soit ils s’en foutent, soit ils adorent les femmes… Moi, j’aime tout des gonzesses : leur conversation, leur compagnie, leurs fringues, leurs nichons, leurs préoccupations, leurs journées à faire du shopping, leurs petits soucis au bureau. Et puis, les nanas, c’est quand même plus métaphysique que les mecs. Elles donnent la vie : ça, c’est un fossé abyssal entre elles et nous. Surtout pour moi qui ai pris des vies… »
Blandine, comme les autres, a succombé – platoniquement – au charme du personnage qu’elle a toujours plus ou moins croisé au siège de l’Action Française, rue Croix-des-Petits-Champs. Mais, ce n’est certainement pas en homme à femmes que cette femme droite et forte considère René mais en homme affamé. Une faim, ou plutôt une soif d’affection, de réconfort et d’amour, tout ce que lui-même a dispensé trop rarement. C’est un grand frère turbulent qui aurait ressurgi dans la vie du couple après une trop longue absence.
À l’exception de ses théories – scabreuses – sur l’Éducation Sentimentalequ’il préconise pour les jeunes filles de la maisonnée, on lui pardonne tout. D’ailleurs, avec le temps, le regard concupiscent qu’il portait sur les jolies adolescentes de la maison – et Jeanne en particulier - se transformera en un paternalisme de tonton gaga. Dès lors, il ne sera plus question de Néné mais bel et bien d’Oncle René
Dans le fauteuil au milieu du salon qui sera sa tribune, l’Oncle René pérore et soliloque en s’amusant de ce rôle de patriarche - après tant d’autres rôles – qu’il campe depuis quelque temps. Alors, il prend la pose, se cale confortablement dans le fauteuil, se sert un Cognac et pose sur sa « famille » le regard bienveillant du conteur dont on attend toujours de nouvelles anecdotes. Cela tombe bien puisqu’il a passé la semaine en se mêlant aux manifestations du Théâtre du Rond-Point où Jean-Michel Ribes a défrayé la chronique en programmant Golgotha Picnic, pièce « scatologique, pornographique et sacrilège » du point de vue des cathos traditionalistes – dont Olivier et Blandine. Avec le mouvement Civitas qui refera parler de lui quelques années plus tard au moment des manifs anti-mariage pour tous, toute la nébuleuse catho tradi s’est réunie pendant des semaines – de décembre 2011 jusqu’en 2012 – pour huer et perturber le spectacle où les étrons tiennent la vedette.
Quand la gouaille de René s’étouffe dans un rire – il souffre de toux homériques depuis des années mais refuse d’aller chez le toubib – c’est après avoir raconté pour la deuxième ou troisième fois comment il a réglé son compte à « la liberté d’expression face à l’intolérance » que prétendait, l’autre soir, défendre une vague actrice, petite protégée d’un ancien ministre de l’Intérieur.
- Je lui ai mis un grand coup de pompe dans le cul au moment où elle allait rentrer dans le théâtre.
- Tu savais qu’elle était la maîtresse de Joxe ? lui demande Olivier.
- Non, sinon je lui en aurais mis deux… C’est surtout cette vieille tante de Ribes, rebelle subventionné et officiel des Arts et des Lettres, à qui il faudrait mettre une bonne fessée !
Le dimanche s’étire dans les rires et les outrances de René qui fanfaronne encore devant un public conquis d’avance. Puis l’atonie dominicale finit par gagner les esprits. On baille un peu… Les filles montent dans leurs chambres tapoter sur leurs iphones et les garçons vont taper quelques balles dans le jardin. Ne reste plus qu’à mater un film. Le cave se rebiffeune fois encore que Néné connaît par cœur. « Le génie, c’est pas Audiard, s’emporte-t-il en prenant à partie le dialoguiste, c’est Simonin à qui l’autre a tout piqué ! Comme Sartre a tout pompé sur Heidegger… D’ailleurs, on se demande quel est le plus illisible! »
Avant le générique, René s’en va à la cuisine se faire un petit sandwich avec le reste de gigot froid. Un verre de pif, un petit casse-croûte et un plateau-repas devant le film avec les copains clôtureront agréablement ce dimanche. Depuis le salon, Blandine et Olivier, attendent dans le canapé, le maître de cérémonie dont, ils en sont certains, ils devront subir les commentaires tout au long du film.
- Tu viens René ? s’impatiente Olivier.
- René, ça commence ! insiste Blandine
Pour seule réponse, un râle, un bris de verre sur le carrelage. Le couple se regarde
- René, ça va ?
Puis, on se précipite àla cuisine. René est plié en deux, sa veste de costume maculée de vin, les deux mains entourant sa gorge cramoisie. Son regard bleu est sorti des orbites. On y lit la panique, une peur inédite. Blandine, infirmière de formation, comprend instantanément ce qui se passe. En médecine, on appelle cela une « fausse route » ; en langage courant, c’est avaler de travers. L’aliment qui reste coincé au plus profond de la gorge étouffe littéralement le patient qui s’impatiente. Alors, selon l’enseignement adapté, Blandine prend René par la partie basse du thorax en appuyant simultanément sur l’estomac. Mais le bougre se débat et ils tombent tous les deux. Olivier, colosse de près de deux mètres, prête main-forte et relève péniblement la mêlée. Blandine recommence la manœuvre afin de secouer comme un prunier – c’est le seul précepte à appliquer en ces circonstances – René qui se tortille, pauvre poisson pris à l’hameçon. Le remue-ménage a alerté la petite Agnès, l’une de leurs filles, descendue de l’étage.
- Appelle le SAMU ! lui crie Blandine qui s’acharne sur René. Dis-leur que c’est une fausse route !
Entend-on encore lorsqu’on va mourir ? Et si oui, René mesure-t-il l’ironie morbide de cette expression ?
« Fausse route » pour lui qui a emprunté tous les chemins de traverse… Et pourquoi pas « voie sans issue » ! ? A-t-il poussé les limites de l’autodérision, cette élégance de l’esprit qu’il cultivait tant, jusqu’à sourire intérieurement de cette farce du destin ? Le bandit de grands chemins mort d’une « fausse route ». Même lui, au mieux de sa forme, n’y aurait pas pensé. Cette fois-ci, ça y est. Entre le gigot du jour et le gigolo d’hier, c’est la barbaque qui aura le dernier mot.
Maintenant, il le sait, il va mourir. Il a tant lu – et parfois vu - sur ceux qui ont réchappé de justesse à la mort. Il est au seuil du grand mystère : il relit une dernière fois le livre de sa vie qui défile au rythme d’une page par seconde.
Chapitre II
L’enfance de l’art
« Au voleur ! Mais arrêtez-le ! » crient les deux employés de la boutique Weston en coursant le jeune voyou qui vient juste de dérober les souliers hors de prix. Et il court, il court le Néné. Ventre à terre, à perdre haleine. Mais les pompes neuves aux semelles trop lisses se dérobent dans sa fuite. Alors, surtout, éviter la chute fatale qui le ramènerait une fois de plus au commissariat. Ne pas recommencer l’erreur précédente en prenant un virage trop serré sur les trottoirs lisses.
« J’ai connu René vers 1967 » se remémore Greg, ce sexagénaire élégant dont rien ne trahit la jeunesse tumultueuse qui accompagnera celle de son alter ego. « À seize ans il avait déjà ce charme vénéneux qui annonçait les conneries ultérieures. Piquer des pompes chez Weston était une sorte de rituel pour les types de la Bande du Drugstore où se côtoyaient les blousons dorés de la bourgeoisie alentour et des petits gars ordinaires comme moi qui venais de la banlieue. Pour René, socialement, c’était plus compliqué : il était fils d’un divorce entre son père, marquis italien, et sa mère, italienne également, artiste lyrique courant le cachet et souvent sans le sou. Il vivait avec elle dans un petit studio. Ils étaient d’ailleurs parmi les rares résidents des Champs. Mais des résidents pauvres dans un quartier riche : cela a beaucoup déteint sur la personnalité de René qui pouvait légitimement invoquer une filiation aristocratique sans en avoir les signes extérieurs qu’on attend généralement. Du coup, il a très tôt dérivé vers la petite délinquance. »
Heureusement, dense est la foule des Champs ; des Champs-Élysées, bien sûr. Alors, il court encore, slalome entre les grappes de flâneurs, bousculant au passage un touriste à quatre épingles qui humait l’air printanier de ce samedi soir en mai. Un regard par-dessus l’épaule l’avertit que les deux types gagnent du terrain. Mais, s’il fuit, René ne panique pas. Ses sens sont en éveil, nullement altérés par la peur, mauvaise conseillère. D’ailleurs, à presque seize ans, a-t-il jamais éprouvé la moindre peur, ce garde-fou moral, cette barrière de l’inconscient devant le danger ? De toute manière, il a tout prévu, et cette fois-ci les flics l’attendront longtemps. La stratégie est imparable.
À l’angle de la rue Marbeuf, un adolescent assis sur sa mobylette, moteur en marche, le hèle.
- Oh ! Néné !
René glisse, manque tomber puis saute à califourchon sur le biplace de la Flandria.
- Allez ! Roule fissa ! ordonne-t-il au complice en adressant un magistral bras d’honneur à ses poursuivants hébétés.
* * * *
- Le problème avec ta meule, c’est qu’elle n’avance pas. Si les mecs de chez Weston avaient un peu insisté, on était faits comme des rats.
Sur les banquettes en skaï du Drugwest, le pendant « sud » du Drugstore en haut des Champs, René a convoqué ses troupes – trois mecs et une jeune fille, pas très jolie – pour une réunion « de travail ». Au lendemain de l’opération qu’il a conduite de main de maître, un resserrage de boulons s’avère nécessaire puisque vraisemblablement, si les cœurs sont vaillants, en revanche l’intendance, elle, ne suit pas.
Flanqué d’un blazer Renoma, d’une chemise Oxford vichy où se coule une cravate de collégien britannique, d’un futal en flanelle grise et chaussé de ses mocs flambant neufs, René s’inscrit harmonieusement dans cette année 1967. Il est blond comme un anglais, sapé comme un lord et ses yeux brillent de ce bleu à faire chavirer les filles. Dans ces sixties anglophiles où l’on a érigé le swinging London en Mecque de toutes les modes, René affiche donc un physique dans le vent. « In » ainsi qu’il se dit à l’époque. Quant à sa petite taille - 1, 65 m -, et son visage poupon, loin de lui inspirer un complexe quelconque, ils sont encore, aux yeux des filles, une valeur ajoutée. Le bon petit diable de la Comtesse de Ségur, lecture commune aux jeunes filles d’alors – avec Sagan et Salut Les Copains - s’incarne étrangement dans ce « petit garçon » de bonne famille à la réputation de voyou qu’on croise régulièrement dans les surprises-parties et les rallyes de la bonne société alentour. Et puis, ma chère, ce Resciniti de Says aux mimiques de James Dean ne vit-il pas sur les Champs-Élysées ?
- Non, décidément, ta Flandria, c’est pas ce qu’il faut, insiste avec une autorité tranquille, mais sans acrimonie, René en tirant sur sa gauloise.
- Tu peux toujours aller chez Weston en trottinette si ma mob te convient pas ! s’insurge le garçon piqué au vif.
- Ni sur ton clou ni en patins à roulettes. Désormais, je passe à la vitesse supérieure : Harley-Davidson.
- Et on peut savoir comment tu vas la payer ta Harley-Davidson ? s’enquiert le fâcheux suscitant une tension incongrue.
- Non, justement, on ne peut pas savoir, rétorque René sèchement.
On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans a dit le poète. Surtout quand on en a à peine seize et qu’on est contraint de jouer à l’homme par la seule présence d’une jeune fille qui fausse la situation en s’improvisant inconsciemment arbitre d’un combat de coqs.
De chaque côté de la table, les deux garçons, biberonnés au western et à la Fureur de vivre, se regardent droit dans les yeux tandis que le juke box recrache My Generationdes Who.
De loin, le barman en veste blanche en train d’essuyer ses verres, observe cette scène à la dramaturgie très exagérée. « Petit René » est un gamin du quartier, un drôle de môme qui connaît tout le monde dans le coin et dit bonjour sans se soucier de « l’étiquette ». Il est partout chez lui. Aussi bien chez les voyous corses qui tiennent les bars à bouchon dans les petites rues adjacentes, entre Jean Mermoz et Ponthieu, qu’à Paris Matchou au Figaro– les bureaux de ces « fleurons » de la presse française sont de l’autre côté de l’avenue. « Petit René » c’est un peu une figure dans le coin. Pas moyen d’échapper à sa démarche chaloupée de petit dur débonnaire. Les caissières du Gaumont et des autres cinémas des Champs, les maîtres d’hôtel, les notaires à particule, les fils de, les filles de joie ou les disquaires savent – ou croient tout savoir – de ce « petit René » abonné au commissariat du 8eoù sa pauvre maman, sa « mamita », est allé le récupérer trois ou quatre fois depuis le début de l’année pour des larcins mais, surtout, des rixes très violentes avec des voyous. Quelle misère quand on a connu petit René « haut comme ça », enfant de chœur et tout et tout… Pour les voyous corses, plus indulgents, « c’est le métier qui entre»…
Sa mère, une très jolie femme mais déjà un peu âgée, est italienne et artiste lyrique. Une figure du Tout-Paris artistique de l’entre-deux-guerres. Avec René, ils habitent un deux-pièces, deux chambres accolées de l’ancien hôtel Claridge dans la galerie du Lido. Quant au père, lui aussi italien, il fait l’acrobate rue du Cirque où il jouit de l’usufruit d’un vaste appartement appartenant à l’une de « ses » veuves.
* * * *
- De toute façon, tu me dois la moitié du prix des groles, insiste le complice de René, une petite frappe déguisée en Vince Taylor, gomina de rocker, blouson de cuir et solides épaules.
- Je t’ai donné le quart, c’est ça qui était convenu. C’est moi qui ai pris les risques. Je suis entré dans la boutique, j’ai demandé à essayer les pompes et je suis parti avec aux pieds.
- Ouais mais c’est ma bécane !
- Ta bécane c’est un tas de ferraille et toi t’es un con ! M’emmerde plus.
René n’a pas élevé la voix, ni ébauché le moindre mouvement. Seul son regard, le bleu laser de ses yeux, trahit la dangerosité de la situation. Il sait que celui-ci ne parle jamais en vain. La réputation du personnage a largement dépassé les frontières des Champs pour parvenir jusqu’au lycée Condorcet où il ronge son frein et élime la patience du corps enseignant. Quelques communistes en herbe, condisciples de René au sein de l’honorable établissement, eurent encore récemment à déplorer des bourre-pifs définitifs.
Alors, soudain, le type à la mob hisse son mètre soixante-quinze de la banquette et esquisse une droite à l’adresse de René. Pas assez rapide ! René, dans un éclair, bloque le bras, et, projette, d’un coup sec, la paume de sa main droite sous le nez du protagoniste… qui s’écroule recta.
Le coup est imparable. Ce sont les Corses qui lui ont appris. Ça te défonce la cloison nasale et percute les sinus. Même un mec taillé comme un bœuf n’y résiste pas.
- Mademoiselle, Messieurs, nous changeons de crémerie ! S’adresse-t-il aux trois autres en se levant doucement comme s’il venait de finir un poker.
* * * *
- Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait à ce pauvre garçon ? se révolte la jeune fille un peu ronde dont René ne connaît même pas le prénom. Elle court presque, essoufflée, pour demeurer à sa hauteur tandis qu’ils remontent prestement les Champs-Élysées.
- Je m’en rends très bien compte et c’est pour cela que je vous demanderais d’accélérer la cadence si ce cela n’est pas trop vous demander, répond-il en homme du monde.
- Mais où allons-nous ? Implore-t-elle.
- Mais chez moi, évidemment…
En 1967, il n’est pas si aisé de trousser une jeune fille de bonne famille. Et, par une géographie sociologique bien ordonnée, René ne fréquente que des jeunes filles de bonne famille ; même si à ses yeux ces catégories qui reposent uniquement sur le vernis que confère l’argent ne lui disent rien. En l’occurrence, la minette du jour appartient à une dynastie de commerçants - ça commence par un « D » et ça finit par un « Y » -, marchands de cafetières et de sèche-cheveux à la veille de faire fortune avec les balbutiements de la grande distribution. Bref, des boutiquiers parvenus.
La vertu étant donc encore un bien précieux – plus pour longtemps – et ces demoiselles s’y accrochant comme à une dot, l’entreprise de René est, pour ces temps reculés, d’une audace folle. Plus encore lorsque la jeune fille en question est un petit boudin, et que sous le kilt à la France Gall, d’horribles panties dignes du XIXe siècle entravent l’assaut.
Mamita, comme prévu, a déserté l’appartement pour le week-end. En ce mois de mai, ses nombreux soupirants et amis se disputent sa présence dans des demeures cossues au cœur de provinces ennuyeuses où l’on parlera d’une langue vipérine des absents restés à Paris. Au milieu d’un salon aux portes-fenêtres ouvertes sur le parc et la mare aux canards – « les canards c’est con mais cela fait cossu » disait Néné – trônera un piano à queue entouré de convives distingués ravis d’écouter les airs d’opéra roucoulés par cette délicieuse Italienne « qui n’a pas la carrière qu’elle mérite »… comme il se dit partout sans que chacun ne lève le petit doigt pour, précisément, appuyer la chère amie.
Pour l’ambiance, René a posé sur son Tepaz Night in white satin des Moody Blues. À moins que cela ne soit le Wither shade of pale du Procol Harum. En tout cas, un slow qui tue cette année-là. Orgue Hammond, voix sirupeuses et guitares veloutées.
Et puis, pour plus d’intimité, il s’en va à la fenêtre qui s’ouvre sur le ciel des Champs ; il en tire les rideaux et plonge le petit salon dans la pénombre. La fille panique quelque peu et tripote nerveusement son collier en or qui repose sur un pull shetland, fort à la mode alors.
- Mais que faites-vous ? s’inquiète la vierge effarouchée loin de ses terres de Neuilly qu’elle quittait pour venir s’encanailler auprès de cette terrible « Bande du Drugstore » qui défraie la chronique des beaux quartiers.
- Vous voyez, je campe le décor, répond René, satisfait en s’asseyant sur le divan.
- Mais quel décor ? s’affole-t-elle en jetant un regard circulaire qui s’achève à la porte, seule issue de secours.
René, tranquille comme un séducteur de série B, la gouaille bien en bouche, insiste dans le registre en s’asseyant dans le divan.
- J’installe le « mood » comme on dit. Je sublime la banalité des sentiments… j’ornemente ce moment avec vous.
La nana, décontenancée par la tirade, baisse la garde mais ne se rend pas encore et s’obstine à demeurer debout devant le prédateur.
- Je crois que je devrais partir, tente-t-elle guère convaincue.
- Et moi, je crois que non… réplique-t-il plein de promesses dans les yeux.
- Oh ! Je sais ce que vous voulez mais je ne suis pas une fille du Lido, une de vos filles faciles ! se révolte-t-elle en faisant allusion à Tania une superbe Bluebell girl russe dont tout le monde sait que René est l’amant. Ce qui, à seize ans, lui confère un supplément d’âme et de prestige.
- Ça, c’est sûr, vous n’êtes pas une danseuse du Lido… ne peut-il s’empêcher de relever ironiquement en regardant le cul bas et les traits grossiers de cette adolescente revêche.
- Comment dois-je le prendre ?
René, foutrait bien le cageot à la porte mais ce serait dire adieu au trésor tant convoité. Alors, il va lui falloir encore recourir à des trésors de patience, défaire le corsage cousu de fil blanc. Car, lui, contrairement à sa génération, n’a pas attendu la libération sexuelle et les lendemains qui chantent de mai 68 pour se libérer de cette encombrante libido adolescente que la morale d’alors prétend contenir. Sa morale à lui, si tant est qu’il en ait une, ne se situe pas dans la culotte des filles dont il ne voit pas quels préceptes lui en interdiraient l’accès. La bohème de sa mère et la vie dissolue de son père – jamais mariés et vivant chacun de leur côté –, et sa propre vitalité ont d’une certaine manière façonné sa personnalité. Il jouira de la vie sans entraves, sans scrupule, sans vaine morale… sans mots d’ordre.
En attendant, il faut composer avec l’héritière qui a daigné le rejoindre sur le divan.
- Parlez-moi de vous, roucoule-t-elle, intriguée par l’originalité de ce garçon à particule qui vit dans 45 m² avec sa mère… tandis que son père qui pourrait être son grand-père vit à dix minutes d’ici dans un palais haussmannien.
Sa famille, ses origines, sa vie d’adulte sont en effet l’objet de bien des conjectures de la part des gens de son âge et de leurs parents. René le sait et en joue, faisant vibrer des cordes plus ou moins sensibles selon son auditoire. Il en a pour tous les publics : les snobs, les filles, les voyous, etc.
Alors, pour cette fille qu’il doit, sinon séduire, du moins amuser - ce qui revient au même - René se lance dans un exposé digne de la Sorbonne en prenant des airs de conférencier :
« Monsieur Resciniti de Says père est né en 1896, fils d’une dame d’honneur à la cour d’Italie et neveu du Comte Sforza, futur ministre et antifasciste notoire. Il intègre très jeune l’académie militaire de Pinerolo, le Saint-Cyr italien, mais en plus sélect puisque les futurs lanciers sont uniquement des chevaliers, nobles de naissance promis aux plus hautes destinées. La guerre de 15-18 - en Italie, la Première Guerre Mondiale ne commence qu’en 1915 - surprend les dix-huit ans de l’officier fringuant qui est dépêché sur le front à Caporetto, synonyme pour la monarchie italienne de fiasco, retraite, carnage. Blessé trois fois, assez gravement, le capitaine de Cavalerie rêve de devenir pilote de chasse. Mais un éclat d’obus dans l’œil lui interdit cette voie royale. Entre-temps, il aura épousé en deuxièmes noces – sa première femme décède de la grippe espagnole en 1914 - la fille d’un banquier milanais, qui lui donnera deux fils. Puis il partira en mission dans la concession internationale de Shanghai.
La destinée de ce personnage de l’ancien régime était toute tracée et devait logiquement le conduire à devenir général ou sénateur, voire, politicien à l’instar des hommes de sa famille, tous notables. Sauf qu’il était à moitié cinglé et qu’il adorait les gonzesses. Ce dernier, après être revenu de Chine, et suite à un pari stupide - baiser la femme du général, ce qui fut fait – est condamné à de la prison ferme. Il préfère alors s’enfuir, quitter le pays et se faire oublier. Le déserteur est contraint à un long exil.
La honte s’abat sur la famille. Deux enfants nés dans les années vingt grandiront dans le culte de ce père héroïque, mort au front, pleuré et chéri par sa digne et chère épouse. Deux demi-frères qui découvriront le pot aux roses au moment d’incorporer quelque école des officiers de l’Air, sous l’ère mussolinienne quand leur nom, celui de leur père donc, toujours épinglé dans les archives de l’armée, sera à la fois un motif de non-recevoir et, surtout l’objet d’une déplaisante découverte. Non seulement le père est en pleine forme mais il vit à l’étranger. D’abord en Suisse, puis en France où il organisera un trafic d’armes avec l’Espagne en proie à la guerre civile et enfin en Amérique du Sud. Ses accointances avec tout le personnel politique italien démocrate chrétien d’alors et son lien de parenté avec le Comte Sforza - ministre aux affaires étrangères du Roi d’Italie, puis futur exilé sous Mussolini et très ami avec Aristide Briand - c’est lui qui introduira Aristide Briand auprès du Vatican pour obtenir la condamnation de l’Action Française - aideront les entreprises du géniteur indélicat… qui s’engage dans la Légion Étrangère en 1939 au grade de lieutenant.
Encore une guerre, encore du courage, des blessures - à Forbach comme François Mitterrand - et des médailles. Et, surtout, l’aventure, cet appel de l’inconnu, des émotions fortes. L’aventure qui mènera encore ce père jusque dans le château d’une belle veuve, entre Arles et Tarascon, où l’héritière de filatures et d’usines dans le Nord s’est réfugiée. La propriété dans le Midi compte 750 hectares de terrain cultivé, et, désormais, un officier de la Légion, aristocrate italien recherché comme déserteur dans son pays, mais décoré en héros en France. Le marquis de Says s’improvise prince consort et supervisera dès lors la bonne marche des usines de Lille, Roubaix et Tourcoing… avant d’avoir une autre liaison d’où naîtront deux filles. »
Devant ce cours magistral improvisé, la fille sourit et se détend.
- Mais, et vous alors ?
- Moi, je suis issu d’une autre liaison encore. Je suis un « accident » si vous préférez… Mon père a rencontré ma mère, jeune artiste débarquée de Venise à Paris en 1937. Il l’a aimée, comme il aimait toutes les femmes, et vous avez devant vous le fruit de ces amours.
- Alors vous êtes riche ? ose-t-elle
- Riche de promesses, assurément. Mon père ne possède rien. Ni le château ni l’appartement ni les usines. Sa veuve ne lui a rien légué. Quant à ma mère, elle n’a que cet appartement des Champs-Élysées et quelques cachets.
- Vous avez l’air triste, soudain, s’attendrit la fille.
- Un « accident », c’est toujours triste… lâche René dans un soupir.
La réplique qui tue, la corde qui vibre au creux du cœur et des reins de la fille qui s’abandonne enfin pour un baiser. Sur le tourne-disque, Otis Redding a remplacé les anglais en uniforme brandebourg. I’ve been loving you too longsusurre le crooner soul à l’oreille des femmes.
Après des minutes de caresses appuyées et de baisers fougueux – avec la langue ! - René parvient à glisser sa main dans le soutien-gorge de l’allumeuse qui, de ce point de vue, ne manque pas d’arguments. De beaux gros seins d’ivoire qu’il malaxe savamment sous le pull lambswool et le collier en or. Et elle se pâme la gourdasse ! Elle se cabre et gémit de plaisir coupable et de vertu outragée ; tout en se gardant bien, toutefois, d’entrouvrir ses jambes, derniers remparts de la citadelle imprenable.
Otis Redding, c’est imparable. René a déjà éprouvé cette recette qui fait fondre les filles. On ne comprend rien à ce que raconte le mec mais cela n’a aucune importance puisque le phrasé, les cuivres et le rythme syncopé perlent pour lui. C’est un condensé de sauvagerie maîtrisée, de sensualité contenue et d’imaginaire trouble. Ça marche à tous les coups ! C’est Tania qui lui a refilé la recette.
Les cuisses de la fille s’entrouvrent et le Graal se précise.
- Cette fois-ci, je dois vraiment y aller s’affole la fille échevelée, le corsage en bataille et le visage cramoisi.
- Mais on était sur le point de passer aux choses sérieuses, négocie René.
- Justement ! Nous n’avons pas la même conception du « sérieux » répond-elle en se levant afin de remettre de l’ordre dans sa mise.
- Bon, comme vous vous voudrez… consent-il à peine déçu.
Il la baratine une dernière fois, promet qu’on se reverra à la surboum de tel tocard, lui donne une tape sur les fesses indignées et referme la porte comme tombe le rideau. Puis, il se rassoit, se sert un Pschitt orange… et sort de sa poche le collier en or qu’il lorgnait depuis le début de la journée. Cette fois, la Harley-Davidson est à lui !
4f6a5a1e172000ab186cab9454c5ff31